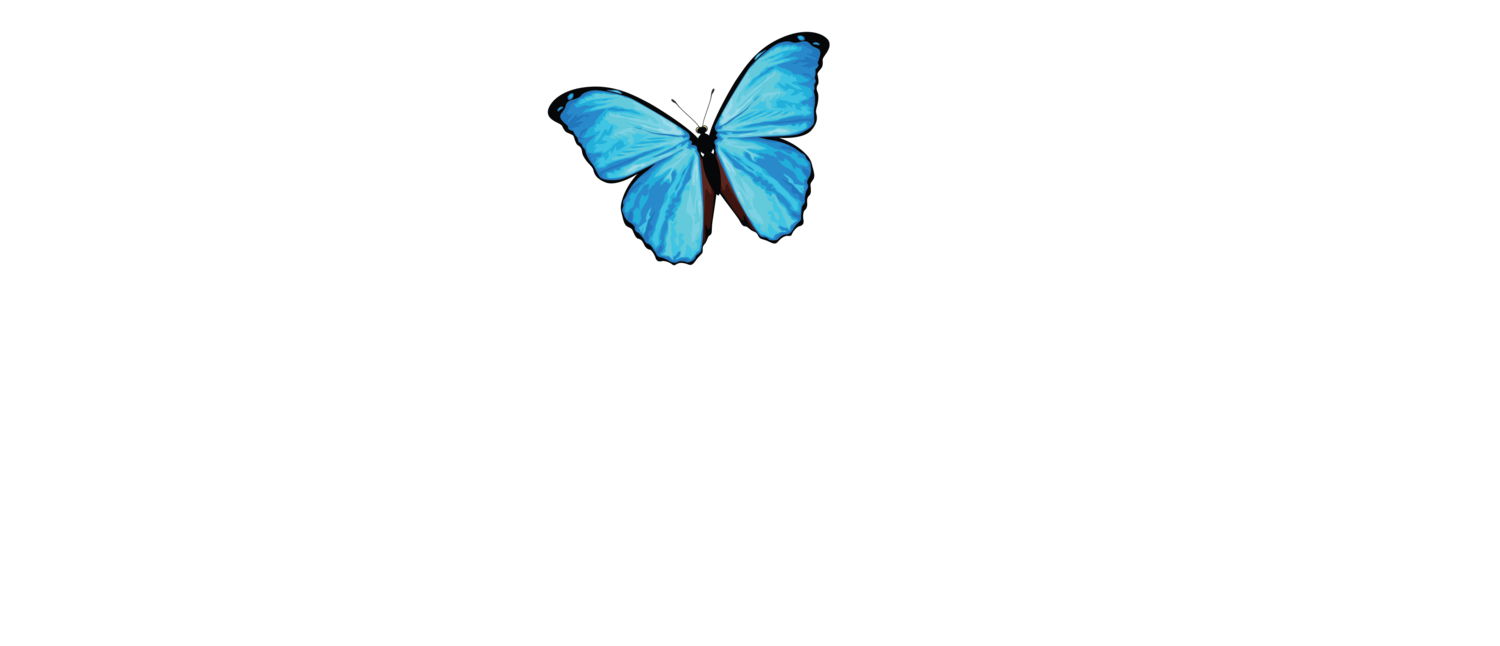Safa Daud
Responsable de la conservation
Safa Daud est chercheuse en doctorat à l'université Goldsmiths de Londres et se concentre sur les impacts environnementaux sur la forêt amazonienne, en particulier sur l'activisme environnemental/juridique transnational dans l'Amazonie brésilienne. Elle étudie l'efficacité des cadres juridiques dans la protection de nos écosystèmes, en particulier la forêt amazonienne, et la manière dont les affaires environnementales sont portées par l'activisme juridique transnational. Son projet est abordé en utilisant les systèmes d'information géographique (SIG) en Amazonie brésilienne, les témoignages indigènes, l'observation participante avec des acteurs clés, l'analyse de documents sur les cadres juridiques. La recherche de Safa vise à comprendre comment l'activisme juridique transnational émerge pour aborder les questions écologiques que les systèmes juridiques existants négligent souvent.
En plus de son travail universitaire, Safa participe activement en tant que bénévole à des projets de conservation. Plus récemment, ils ont contribué à la collecte de données et à l'évaluation des habitats des herbiers marins dans le sud-est de l'Angleterre, démontrant ainsi leur engagement dans les efforts de conservation locaux et mondiaux.
En savoir plus sur Safa Daud
8 juillet 2025
Ce que la COP29 m'a appris sur l'avenir de la conservation de l'Amazonie
Lorsque j'ai atterri à Bakou, en Azerbaïdjan, pour participer à la COP29j'avais l'estomac noué. C'était la première fois que je participais à une conférence mondiale sur le climat de cette ampleur, et pas n'importe quel sommet, mais la conférence des Nations unies sur le changement climatique. Je ne savais pas à quoi m'attendre, ni qui j'allais rencontrer, ni où les jours à venir allaient me mener. J'étais arrivée pour la deuxième semaine, la partie de la COP où les vraies négociations démarrent. Une amie qui était là depuis le début m'a fait un rapide compte rendu de la première semaine et a ajouté : "C'est maintenant que les véritables négociations commencent". Et elle avait raison.
La COP29 s'est concentrée sur un thème central : le financement de la lutte contre le changement climatique. Des salles de négociations aux événements parallèles, la conversation a tourné autour de la manière de réunir au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation, en particulier dans les pays à faible revenu. Mais ce qui a rendu cette COP unique, c'est la volonté croissante d'aller au-delà des mécanismes traditionnels fondés sur le marché, mécanismes traditionnels fondés sur le marché comme les compensations de carbone, et à adopter des des approches non marchandes qui privilégient la coopération, les connaissances locales et la résilience écologique à long terme. La question n'était pas seulement de savoir combien d'argent devait être versé, mais aussi comment il devait être dépensé et qui devait prendre la direction des opérations.
A l'intérieur des zones verte et bleue
Une chose que l'on apprend rapidement à propos de la COP, c'est qu'il est impossible de s'ennuyer. L'événement est massif et déborde d'énergie. COP est divisée en deux zones principales : la zone verte et la zone bleue. La zone verte est ouverte au public et propose une variété d'expositions interactives, d'événements pour les étudiants, de démonstrations de technologies climatiques et d'espaces de réseautage. C'est là que les pays et la société civile présentent leurs innovations dans une atmosphère vibrante et parfois festive - oui, il y avait aussi des collations et des cadeaux ! C'est amusant, c'est inspirant et cela vous donne un aperçu de la façon dont les solutions climatiques sont imaginées à partir de la base.
Mais c'est dans la zone bleue que les vraies décisions sont prises. C'est l'espace réservé aux négociateurs, aux délégués nationaux, aux dirigeants autochtones, aux ONG, aux experts juridiques et aux scientifiques. C'est ici que les objectifs climatiques sont débattus, que le langage est disséqué et que les accords sont conclus ou bloqués. C'est là que j'ai passé la majeure partie de mon temps, représentant fièrement l'Amazon Center for Environmental Education and Research (ACEER),une organisation engagée en faveur de la biodiversité, des droits des populations autochtones et de l'éducation dans le bassin de l'Amazone.
Se trouver dans la zone bleue était à la fois exaltant et, parfois, politiquement chargé. Les discussions sur le financement de la lutte contre le changement climatique étaient essentielles et attendues depuis longtemps. Une part importante de l'ordre du jour de la COP29 portait sur la manière dont les pays développés mobiliseraient des fonds pour aider les pays en développement à respecter leurs contributions déterminées au niveau national (CDN). Il ne s'agit pas seulement d'une question technique, mais d'une question d'équité climatique et de responsabilité historique. Bien que des progrès aient été réalisés, comme l'engagement de mobiliser 300 milliards de dollars par an, de nombreux délégués des pays du Sud se sont inquiétés du fait que les promesses n'atteignaient toujours pas les 500 milliards de dollars initialement demandés et qu'il n'y avait que peu de garanties exécutoires. Ces négociations financières sont cruciales, en particulier pour les nations de première ligne déjà confrontées à des impacts climatiques disproportionnés.
Parmi ces conversations essentielles, il y avait une lacune notable dans l'attention portée au plus haut niveau à la conservation et à la gouvernance des forêts, en particulier en ce qui concerne l'Amazonie. Alors que des mécanismes tels que REDD ont été présentés, y compris des mises à jour sur les nouvelles initiatives liées au marché pendant la COP29, beaucoup s'appuient encore sur l'échange de crédits de carbone, un modèle qui a fait l'objet de sérieuses critiques pour son incapacité à protéger les forêts, à empêcher l'écoblanchiment ou à garantir les droits fonciers des populations autochtones. La vision plus large de stratégies de conservation juridiquement applicables et coordonnées au niveau régional a été quelque peu mise de côté. Lors d'une conférence si axée sur l'argent, les réformes structurelles nécessaires pour que cet argent compte, en particulier pour protéger des écosystèmes comme l'Amazonie, n'ont pas toujours occupé le devant de la scène.
Une lueur d'espoir : la session de l'AGC-ARM
Puis est arrivé le moment qui a tout changé pour moi : le mécanisme régional conjoint d'atténuation et d'adaptation pour l'Amazonie (JMA-ARM). Nichée dans un événement parallèle co-organisé par la Bolivie et la troïka des présidences de la COP (EAU, Azerbaïdjan, Brésil), cette session a été une bouffée d'air frais. Elle était entièrement consacrée à une stratégie régionale pour la conservation de l'Amazonie, la chose même que j'étais venu chercher. JMA-ARM est un cadre politique qui réimagine la protection des forêts non pas comme une marchandise, mais comme une mission régionale, dirigée par les autochtones et juridiquement coordonnée. Proposé à l'origine par la Bolivie en 2012 comme une alternative non marchande à REDD+, le mécanisme a réapparu comme l'une des stratégies de conservation les plus prometteuses discutées lors de la COP29.
Au fond, JMA-ARM rejette la logique des marchés du carbone. Il met plutôt l'accent sur la résilience des écosystèmes, la gouvernance autochtone et le financement international direct sans les contraintes des systèmes de compensation. Au cours de la session, le ministre bolivien de l'environnement a parlé avec passion de la nécessité d'une action unifiée dans les nations amazoniennes, tandis que le Brésil a souligné l'importance de la cohérence entre les politiques nationales et régionales, en soulignant que déforestation réduite dans un pays se déplace souvent vers un autre pays dont les lois sont moins strictes. La première phase pilote de l'AGC-ARM est prévue pour 2025, avec l'espoir d'un déploiement complet lors de la COP30 au Brésil, une étape potentiellement historique.
Ce qui m'a le plus enthousiasmé dans le projet JMA-ARM, ce n'est pas seulement son contenu, mais aussi son énergie. Il n'était pas vague ou théorique. Il regorgeait de propositions concrètes, comme l'expansion de l l'agroforesteriel'investissement dans l'écotourisme autochtone, la garantie des droits fonciers et l'intégration de la gouvernance forestière dans les systèmes juridiques nationaux. Pour l'ACEER, dont le travail comprend l'éducation à l'environnement, la recherche et les partenariats avec les populations autochtones, il s'agit d'un appel à l'action. Nous sommes parfaitement positionnés pour contribuer, établir des liens et aider à mettre en œuvre la plupart de ces objectifs.
Droits fonciers, droit et pavillon amazonien
Parallèlement, le pavillon de l'Amazonie (caractéristiques pendant la copie) à la COP29 a offert des perspectives intéressantes sur la gouvernance foncière et l'inclusion des populations autochtones. Les intervenants ont souligné que la déforestation ne peut être résolue sans une réforme du régime foncier, l'application de la loi et le respect des connaissances écologiques traditionnelles. Dans des régions comme le Pará et le Maranhão, en Amazonie, les projets d'infrastructure sont souvent mis en œuvre sans consultation des populations autochtones. Les registres fonciers restent obsolètes, l'application de la loi est faible et l'exploitation forestière et l'élevage illégaux continuent de prospérer.
Le registre environnemental rural (CAR) du Brésil Registre environnemental rural (CAR) a été présenté comme un outil permettant d'améliorer la transparence foncière, mais il présente des lacunes au niveau de la mise en œuvre. La technologie satellitaire facilite le suivi de la déforestation, mais elle ne suffit pas à elle seule. En l'absence de responsabilité juridique et de volonté politique, l'application de la loi reste précaire. L'avocat spécialiste de l'environnement Enéas Xavier, avec qui je me suis entretenu au cours de la semaine, a expliqué que de nombreux États amazoniens s'efforçaient de mettre à jour et d'aligner leurs lois, mais qu'ils avaient besoin d'un soutien, à la fois financier et institutionnel, pour réussir.
La montée de l'activisme juridique transnational
Ce dont j'ai été témoin tout au long de la COP29, c'est de l'émergence de l'activisme juridique transnational en tant que force sérieuse dans la gouvernance climatique. La COP29 a montré que la bataille pour la protection de l'Amazonie n'est pas seulement écologique, elle est aussi juridique et politique. Des procès intentés par les autochtones contre les entreprises d'extraction aux accords régionaux tels que le JMA-ARM, nous entrons dans une ère où le droit et la politique deviennent nos outils les plus puissants pour la protection de l'environnement. Et pour des organisations comme l'ACEER, cela signifie qu'il faut aller de l'avant : construire des ponts entre la science et le droit, entre les communautés locales et les plates-formes mondiales.
L'activisme juridique transnational nous offre un nouveau moyen de canaliser les preuves scientifiques, d'élever les voix des indigènes et de lutter contre l'impunité en matière de destruction de l'environnement. Il crée un pont entre l'expérience locale et la responsabilité internationale.
En parcourant la zone bleue, je revenais sans cesse à cette question : que se passe-t-il lorsque les cadres juridiques sont façonnés non seulement par des diplomates ou des entreprises, mais aussi par des scientifiques, des communautés et des éducateurs ? La réponse, je crois, est la transformation, non seulement des politiques, mais aussi du pouvoir et de l'influence
Oui, mon parcours au sein de la COP29 a commencé dans l'incertitude. Je me suis sentie dépassée, anxieuse, ne sachant pas comment naviguer dans un espace aussi complexe et aussi grand. Mais à la fin, je suis repartie avec de la clarté, une orientation et un sens plus profond de l'objectif à atteindre. Les conversations que j'ai eues, les événements auxquels j'ai participé et les personnes que j'ai rencontrées m'ont rappelé qu'un changement significatif ne se produit pas de manière isolée. Il se produit lorsque des scientifiques, des juristes, des éducateurs, des dirigeants autochtones et des décideurs politiques se réunissent, non seulement pour partager des idées, mais aussi pour construire des cadres qui modifient le pouvoir, financent des solutions et protègent les systèmes vivants dont nous dépendons tous.
L'Amazonie n'est pas seulement une forêt. C'est un avenir. La COP29 a clairement montré que le monde commence enfin à la considérer comme telle.
Où allons-nous maintenant ?
Alors que nous nous dirigeons vers un paysage post-COP29, ACEER est dans une position puissante pour construire sur cet élan. En s'engageant avec les partenaires du JMA-ARM, en soutenant le plaidoyer juridique mené par les autochtones et en traduisant la recherche scientifique en actions politiques pertinentes, nous pouvons contribuer à façonner un avenir plus juste et plus efficace pour l'Amazonie.
Si vous faites partie d'une organisation, d'une institution académique ou d'une communauté locale qui souhaite collaborer, discutons-en. Le travail de protection de l'Amazonie ne peut être pris à la légère. Il nécessite des réseaux, des partenariats et une conviction commune que la conservation et la justice doivent aller de pair.
Prenez contact avec nous. Participez à notre mission. Participez à l'avenir de l'Amazonie.